|
|
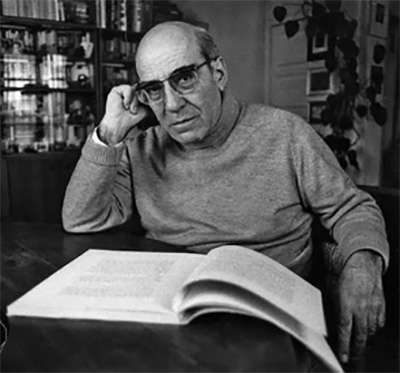 |
|
EmmanuelRobles |
|
|
Oran 1914 Boulogne-Billancourt1995 |
|
|
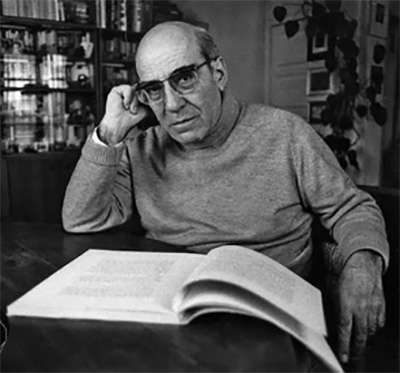 |
|
|
Emmanuel Roblès est né à Oran dans une famille ouvrière d’origine espagnole, installée en Algérie depuis plusieurs générations. Son père, maçon, étant mort du typhus quelques mois avant sa naissance, il fut élevé par sa mère et sa grand’mère maternelle. Très doué pour les études, après ses classes à Oran, il entre à l’École normale d’Alger puis exerce dès 1933 , des fonctions en Oranie. Il fait son service militaire à Blida en 1937, puis à Alger. Ayant rencontré Albert Camus à une répétition du théâtre de l’Équipe il se lie d’amitié avec lui et rejoint le groupe des jeunes écrivains qui se retrouvent autour du libraire-éditeur Edmond Charlot : René-Jean Clot, Gabriel Audisio, Max-Pol Fouchet, Claude de Fréminville. Il collabore au journal Alger Républicain et édite son premier roman , l’Action, en 1938. Dans le même temps, il prépare une licence d’Espagnol à la Faculté des lettres et traduit les essais poétiques de Federico Garcia Lorca. Il épouse en 1939 Paulette Payade et aura un fils, Paul, en 1942. La guerre l’arrête dans ses études, mais ne l’empêche pas de publier deux romans La vallée du Paradis, puis Travail d’homme. Tout d’abord interprète auxiliaire de l’Armée, il devient en 1942 correspondant de guerre pour l’Armée de l’Air et écrit dans son hebdomadaire Ailes de France. A ce titre, il est envoyé en France, en Italie, en Sardaigne et participe à des opérations de bombardement sur l’Italie du Nord et des îles de l’Adriatique. Démobilisé en 1946, il collabore à Paris à divers journaux : Le Populaire, Gavroche, Combat, Aviation française. En 1947, c’est la naissance de sa fille Jacqueline et son retour à Alger où il fonde la revue littéraire Forge. Il anime aussi le Magazine des Lettres et des Arts à Radio Alger. En 1948, il reçoit le Prix Femina pour les Hauteurs de la Ville. Il rédige sa première pièce de théâtre Montserrat. Cette œuvre jouée à Alger et à Paris au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, obtient un retentissement considérable et il reçoit le prix du Portique en juin 1948 ; Il fonde aux Éditions du Seuil en 1948 la collection Méditerranée dans laquelle il publie les principales oeuvres d’auteurs maghrébins d’expression française, tels que Mouloud Feraoun, Mohammed Dib. En 1952, sa pièce La vérité est morte est jouée à la Comédie française et il produit un roman qui connaît un vif succès Cela s’appelle l’aurore , adapté au cinéma par Luis Bunuel Passionné aussi par le théâtre, il fonde une compagnie d’amateurs, le Théâtre de la rue. Tant à Alger qu’à Paris, il fera preuve d’une activité incessante. Tout au long de sa vie il publiera de nombreux romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des poésies. Son œuvre est très abondante et appréciée dans le monde littéraire. A Paris, il est membre du Comité directeur du mouvement Peuple et Culture. En 1973, il devient membre de l’Académie Goncourt, élu au fauteuil de Roland Dorgelès. Son dernier roman, Camus frère du Soleil, avait été remis à son éditeur quelques jours avant son décès. Emmanuel Roblès a énormément voyagé , en Europe, au Mexique, au Japon, au Tibet, pays auquel il s’est particulièrement intéressé. Depuis 1991, la ville de Blois décerne chaque année à un romancier le Prix Emmanuel Roblès. Quoique que bien ancrée en Afrique du Nord, l’œuvre de Roblès est plus généralement méditerranéenne, s’étendant aussi à l’Italie ou à l’Espagne. Il y a peu de folklore ou de couleur locale dans ses récits. Ceux-ci sont toujours centrés sur les individus leurs passions, leurs conflits, leur recherche désespérée du bonheur. Dans un monde difficile les hommes doivent lutter pour être heureux, mais ils doivent être mus par des valeurs morales humanistes. Sobres et rigoureux, ses héros sont cependant capables de passions, de démesure, mais sans jamais aller à l’abandon de leurs valeurs. Ils acceptent l’échec et la mort avec dignité, conscients que le destin de l’homme n’est pas d’être heureux, mais de le devenir. Dans son autobiographie Jeunes Saisons (Ed. Baconnier Alger 1961) Roblès a conté ses souvenirs d’enfance à Oran. Nous en publions ci-dessous quelques extraits. « La même joie, toujours neuve et légère, bondit en moi chaque fois que je retourne à Oran, chaque fois que mon regard, du plus loin, distingue enfin la croix de Santa Cruz et son vieux fort espagnol, roux et trapu comme un lion couché. Mais les souvenirs jaillissent surtout de chaque pierre de ce quartier sans caractère où mon enfance s’est écoulée. Il se trouve pressé entre la gare et la falaise qui domine le port sur une pente assez raide qui autrefois gênait les charretiers.. Voici la rue Bruat où je suis né et la rue de Lourmel qui ravinaient les pluies. Et voici la place Hoche « la Plazoche », comme nous l’appelions, avec le buste en bronze du général et sa tête verdâtre de pestiféré. Le général paraissait surtout complètement abruti par le tintamarre des tonneliers dans les caves Sénéclauze toutes proches. Nous jouions à parcourir la rue en sautant de futaille en futaille, celles-ci rangées le long des murs. Des figures familières nous entouraient alors, qui ont disparu aujourd’hui. Où sont donc les deux guitaristes aveugles qui répétaient en face de ma maison ? De ma terrasse souvent je les écoutais. Une grande partie de mon enfance s’est déroulée ainsi au chant aigre-doux des guitares… Ces deux guitaristes contribuaient à donner à nos rues une atmosphère andalouse qu’elles ont perdue aujourd’hui… Je me souviens d’une marchande d’herbes, une vieille femme s qui vendait pour un sou cinq ou six feuilles de mûrier destinées à nos vers à soie. Elle s’appelait Dona Maria et l’on ne voyait d’elle dans la pénombre de sa boutique qu’une tête ridée et sèche de tortue. Cette boutique était aussi son logement, meublée d’un énorme lit et d’une armoire toute noire et haute comme un monument funéraire. Pendus au mur, des sachets de camomille, de salsepareille, de verveine, de queues de cerise exhalaient une odeur sèche et un peu suffocante. De nombreuses images pieuses, violemment colorées couvraient les intervalles. Dans un coin, une veilleuse brûlait mélancoliquement et donnait à la pièce une apparence de sanctuaire… Je me souviens du boulanger qui dormait l’après-midi, assis sur une chaise, près de sa devanture, en long caleçon blanc et tricot rayé, ses gros bras à l’air, le ventre entre les cuisses écartées. Dans cette posture incommode, il faisait la sieste au soleil, les joues encore blanchies de farine, sa grosse tête chauve inclinée sur la poitrine. Jamais il ne nous vint à l’idée de lui faire quelque farce tant il nous en imposait, même endormi, désarmé. Je veux encore rappeler d’autres silhouettes familières, les gitanes qui allaient pieds nus, les yeux hardis en balançant leurs jupes de couleurs vives dans une démarche aisée, libre et insolente. Elles proposaient de maison en maison des dentelles et des fleurs en papier…. L’hiver, des marchands de pâtisserie ambulante nous proposaient aux environs de Noël, du nougat d’Espagne, « el turron », des dragées aux amandes et des fruits confits, mais à l’approche de Pâques, c’étaient les mounas. En toute saison ils offraient à la gourmandise des passants, et à la voracité des mouches, meringues à goût de plâtre, « mantecaos », lourds de graisse et des gâteaux secs parfumés à l’anis et mouchetés de sucre rose. Nous connaissions aussi les marchands de fromages qui traversaient le quartier avec, sur la tête un panier plat où s’étalaient des fromages sur un lit de feuilles de vigne. Des porteurs d’eau indigènes criaient sous les fenêtres « ahoua » en frappant sur leurs bidons. Les poissonniers, coiffés de la casquette des inscrits maritimes, allaient, leur panier sous le bras, un bras audacieusement tatoué le plus souvent. Ils savaient parler aux dames et faisaient les jolis cœurs, vantant les yeux de l’une et le teint de l’autre…Les paniers de poisson étaient ornés d’algues brunes et vertes et sentaient la mer. De loin en loin, en période de sécheresse, des marabouts arabes, en robe et turban immaculés, venaient dans nos rues pour recueillir des oboles en promenant un petit taureau de sacrifice aux cornes ornées de rubans. Et ces défilés, avec les étendards de soie multicolore au son des flûtes, et des tambourins, me ravissaient. Je me souviens de Pépé le rémouleur et de l’aigre chanson de son syrinx. De Manuel el Gordo, le rétameur, qui alertait les clients en frappant une casserole sur un rythme particulier. De Batista el Tuerto qui rempaillait les chaises et raccommodait la vaisselle en utilisant des instruments ingénieux qu’il avait conçus lui-même. De bonne heure le matin, passait le marchand de lait avec ses chèvres. Les sonnailles me réveillaient. Tous ces visages , tous ces bruits, ces appels, appartenaient intimement à mon univers d’enfant. Je les revois, je les entends quand je retourne dans ce coin du monde où habite encore ma mère. Ils sont vivants dans une zone privilégiée de ma mémoire et même quand je suis très loin et comme étranger à ces années englouties. Un rien suffit parfois à les faire revenir, affleurer avec une puissance d’évocation qui me trouble, me rend triste, et c’est peut-être là ce qu’on appelle la nostalgie. Fin mai, apparaissaient les marchands de glace, des Alicantais qui traversaient la mer en une nuit sur le pont des petits vapeurs de la SGTM pour venir vendre dans les rues d’Oran pendant tout l’été la « crème à la vanille-chocolat ». Ils portaient sur le dos, retenu par une large courroie, à la manière des marchands d’oublies, un grand seau cylindrique tout nickelé. Et sur leur chapeau de paille, un écriteau disait le nom de la firme : La Nueva Ibense, la Valenciana, Alhambra, Polo norte… Notre ennemi mortel restait Latigo-Moro », l’homme aux chiens. Lorsque la sinistre voiture grise de la fourrière passait avec ses cages pleines de bêtes gémissantes, nous nous mettions en chasse pour faire le vide devant elle. L’attrapeur allait seul. Très loin suivait un agent, l’air ennuyé. Le cheval cheminait, docile, s’arrêtait sur un simple claquement de langue de son maître. Ce qui nous étonnait, c’était la manière dont les chiens en général, se faisaient stupidement capturer. Dès que l’homme à tête de dogue s’avançait vers eux, le regard fixe, la démarche lente et inquiétante, ils s’aplatissaient à terre, en geignant, sans songer à fuir. Il nous semblait que le vieux les fascinait. Si nous réussissions à faire échapper un chien, l’attrapeur nous insultait, menaçait de nous étrangler avec son terrible nœud en fil de cuivre. Nous étions ravis, moins d’avoir sauvé la bête (nous n’avions pas un amour exagéré des animaux) que d’avoir mis Latigo-Moro en échec et d’une certaine manière, d’avoir protégé le faible contre le fort, ce qui constituait l’essentiel de notre morale. Tel était mon quartier à cette époque, ruelles montantes, maisons basses, sans un arbre pour attendrir la sécheresse des murs. Tout un petit peuple s’y pressait, d’ouvriers-maçons, de fabricants d’espadrilles, de marchands ambulants qui s’exprimaient en un patois espagnol, âpre et chantant. On y parlait peu l’arabe et le français et les premiers phonographes à pavillon faisaient surtout entendre des airs d’Andalousie…. » Odette Goinard Bibliographie Denise Bourdet, Emmanuel Robles, dans Visages d’aujourd’hui. Paris, Plon 1960. Guy Dugas : Emmanuel Roblès, Une action, une œuvre. Préface de Michel Tournier de l’Académie Goncourt. Alger éditions du Tell 2007. Emmanuel Roblès et l’hispanité en Oranie, actes du Colloque d’Oran sous la direction de Guy Dugas. Paris l’Harmattan 2012. |